Actualités
Gestation pour autrui : «En Inde, les mères porteuses sont réduites à l'état d'esclaves»
Par Figaro Paul Sugy (Journaliste du Figaro)
FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN -
Après une longue enquête, Sheela Saravanan révèle les conditions dans lesquelles se déroule la gestation pour autrui en Inde : très pauvres, les mères porteuses sont retenues en quasi captivité, sans aucun soutien psychologique. Un récit bouleversant.
Sheela Saravanan est une chercheuse indienne, titulaire d'un doctorat en santé publique , et a travaillé dans plusieurs universités allemandes. Elle appartient notamment à l'Institut d'Éthique et d'Histoire de la médecine, à l'Université de Göttingen. Féministe, elle s'intéresse aux violences faites aux femmes en Inde et dans les pays du Sud, ainsi qu'aux technologies de reproduction, en particulier la PMA.
Elle a mené une longue enquête auprès des mères porteuses en Inde, et a publié à la suite de ses recherches A Transnational Feminist View of Surrogacy Biomarkets in India(Springer, 2018), un document réalisé à partir de nombreux entretiens. Elle y révèle les conditions terribles dans lesquelles les mères porteuses sont étroitement surveillées tout au long de leur grossesse. Entretien exclusif.
Esclavage moderne en France : «Ça peut arriver au coin de la rue»
Faits divers|Zoé Lauwereys (@zlauwereys)
Les prud’hommes ont donné raison à quatre Marocains, « esclaves modernes » de leur patron. Ils font partie des 129 000 personnes exploitées en France en 2018.
« Le patron ne nous a presque rien donné. On était exploité », témoigne l’un des quatre Marocains qui ont eu gain de cause en référé devant le conseil de prud’hommes de Châteauroux (Indre). Jeudi soir, la justice a accordé à chacun de ces quatre « esclaves modernes » une provision de salaire allant de 3500 à 5900 euros, rapporte La Nouvelle République.
Ces ouvriers avaient été recrutés au Maroc par un employeur d’Aigurande. Il leur avait été promis un CDI payé 1400 euros net par mois, des papiers et un logement. La réalité a vite fait déchanter les quatre hommes. Arrivés en juin 2017 pour les uns, en janvier 2018 pour les autres, ils se retrouvent à tailler du bois 12 heures par jour et à travailler sur le chantier d’un restaurant le week-end. Leur logement supposé décent est un appartement à peine meublé où ils dorment dans la même pièce sur des matelas posés à même le sol. Le tout, pour une centaine d’euros par mois. Le quatuor dit être peu nourri, certains affirment même avoir perdu du poids.
Lorsqu’en mai 2018 les ouvriers réclament leur dû, le patron s’agace, déchire leurs contrats et les met à la rue. Les trois hommes sont obligés de dormir dehors. Là, les habitants de la commune, qui n’hésitent pas à dénoncer cet « esclavage moderne », se mobilisent et, dans un élan de solidarité, les aident à poursuivre leur employeur.
Bien souvent, le mode opératoire et les profils des victimes se ressemblent, explique au Parisien Sylvie O’Dy, présidente du Comité contre l’esclavage moderne (CCEM) qui accompagne les victimes d’esclavage domestique et leur apporte un soutien juridique. « Ce sont en grande majorité des étrangers, avec des déficiences intellectuelles, des profils vulnérables, qui se soumettent plus facilement à l’emprise de leurs employeurs », décrit Sylvie O’Dy. Les victimes cèdent ainsi à la fausse promesse d’un travail bien rémunéré, d’un lit et d’une vie meilleure : leurs papiers sont en fait confisqués, ils ne sont pas payés, privés de liberté, vivent dans des conditions contraires à la dignité humaine et subissent de mauvais traitements ».
« Leurs employeurs appartiennent à toutes les catégories socio-professionnelles. On retrouve des victimes dans les grands ensembles et dans les beaux quartiers. Les diplomates et les nababs n’ont pas le monopole de ces pratiques. Il arrive que la pauvreté exploite la misère », détaille le CCEM sur son site.
Sylvie O’Dy se rappelle ainsi d’une jeune fille que le voisinage avait aperçue dormant sur un balcon en plein milieu du XVe arrondissement de Paris ou d’une autre qui mangeait ce qu’elle trouvait dans les poubelles de la copropriété parisienne. A l’instar de Aih, une Indonésienne exploitée à Garches (Hauts-de-Seine) ou de cette Congolaise d’une vingtaine d’années, forcée par un couple à travailler de 6 heures à minuit sans compensation financière à Coignières (Yvelines).
129 000 personnes victimes d’esclavage moderne en France
Concernant les emplois saisonniers, aussi pénibles soient-ils, ils « ne relèvent pas forcément de l’esclavage moderne », indique Sylvie O’Dy, qui se souvient pourtant d’une affaire remontant à 2014. Près d’Epernay (Marne), 237 vendangeurs polonais avaient été découverts par les gendarmes exploités par un couple de compatriotes. « Logés dans deux maisons, jusqu’à 14 entassés sur des lits superposés et des matelas posés au sol, dans des chambres et des caves sans chauffage, jonchées de sacs-poubelles et ne répondant à aucune norme : installations électriques dangereuses, absence d’extincteur, fenêtres inaccessibles, moisissures au mur et amiante au plafond… », écrivait le Parisien au moment du procès en janvier 2017.
D’après les estimations du Global Slavery Index, 129 000 personnes sont victimes d’esclavage moderne en France en 2018.
Ces chiffres englobent les victimes de l’exploitation sexuelle, de mariages forcés et ceux exploités par le travail. « Le nombre est toutefois difficile à estimer, c’est un phénomène par définition caché. »
« Ça peut arriver au coin de notre rue »
Pour sa part, le CCEM a accompagné 176 personnes cette année (600 personnes depuis 1998) et engagé 250 procès depuis sa création. « Ce n’est qu’une infime partie du phénomène », commente Sylvie O’Dy. C’est souvent l’intervention d’un tiers qui met fin au cauchemar, avec « un voisin qui s’aperçoit de la situation et accompagne la victime chez la police ou vers un point d’accès au droit ». Mais la présidente de l’organisation déplore : « Beaucoup ne portent pas plainte, car leurs exploitants sont des puissants. Ils craignent des représailles envers leurs familles. »
A la création du comité en 1994, « les gens ne pensaient pas que l’esclavage existait encore. Il avait été aboli en 1848. » Depuis, le CCEM et sa trentaine d’avocats bénévoles n’ont cessé de se battre. En 2013, la réduction en esclavage, la servitude et le travail forcé sont introduits dans le Code pénal, mais cela ne suffit pas tout à fait, dit la présidente du CCEM qui appelle à la vigilance de tous : « Ça peut arriver au coin de notre rue, il ne faut pas rester indifférent. »
Nouveauté
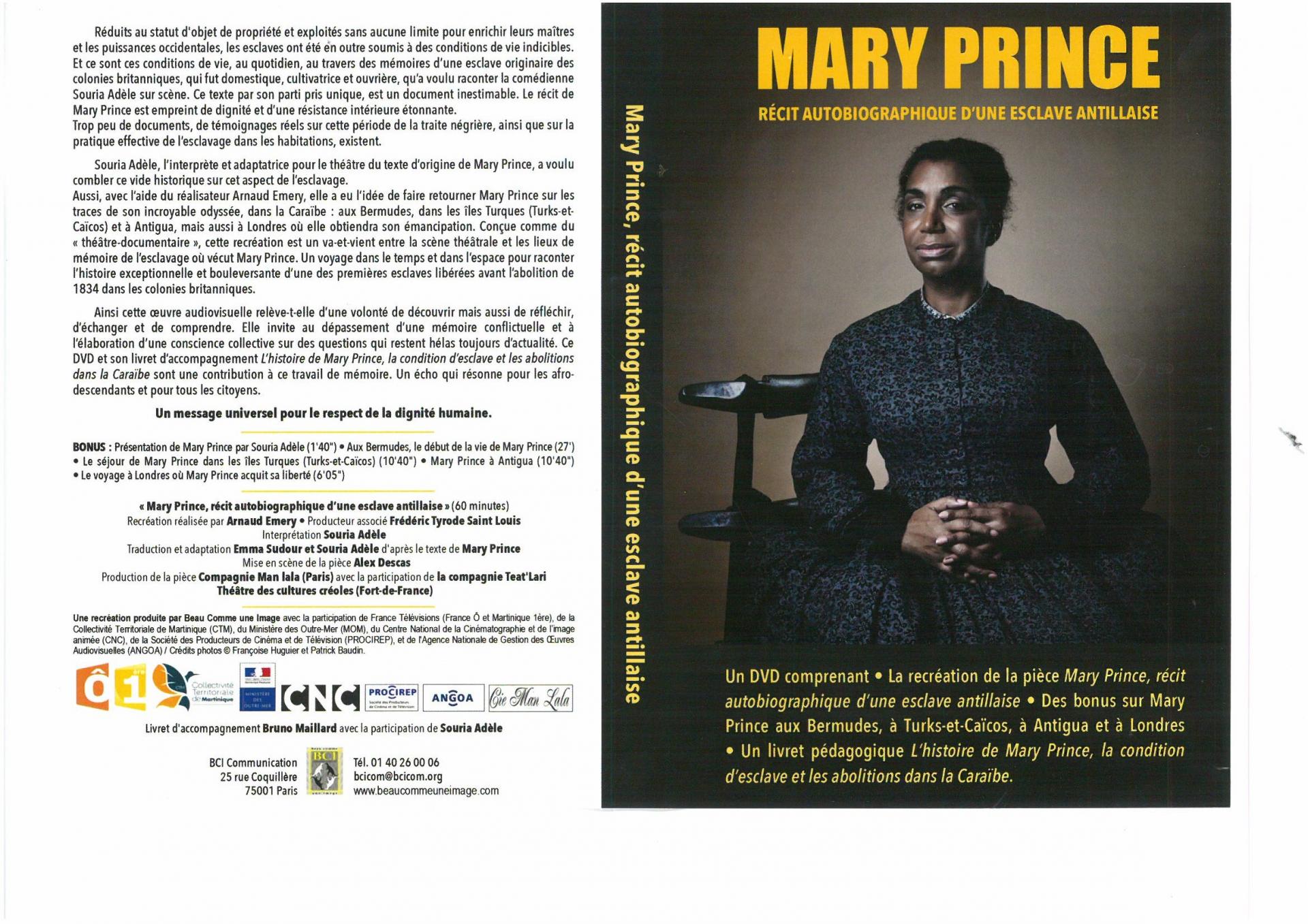
Ajouter un commentaire












